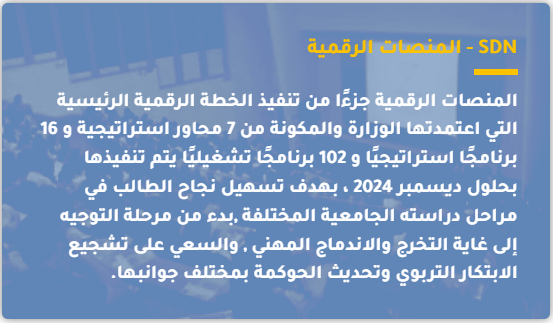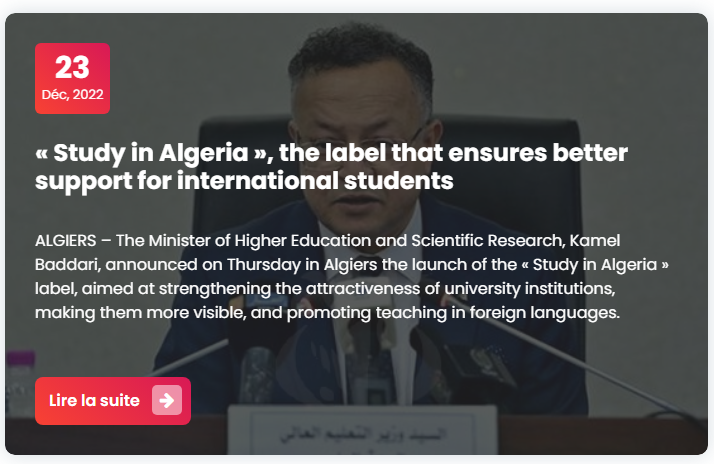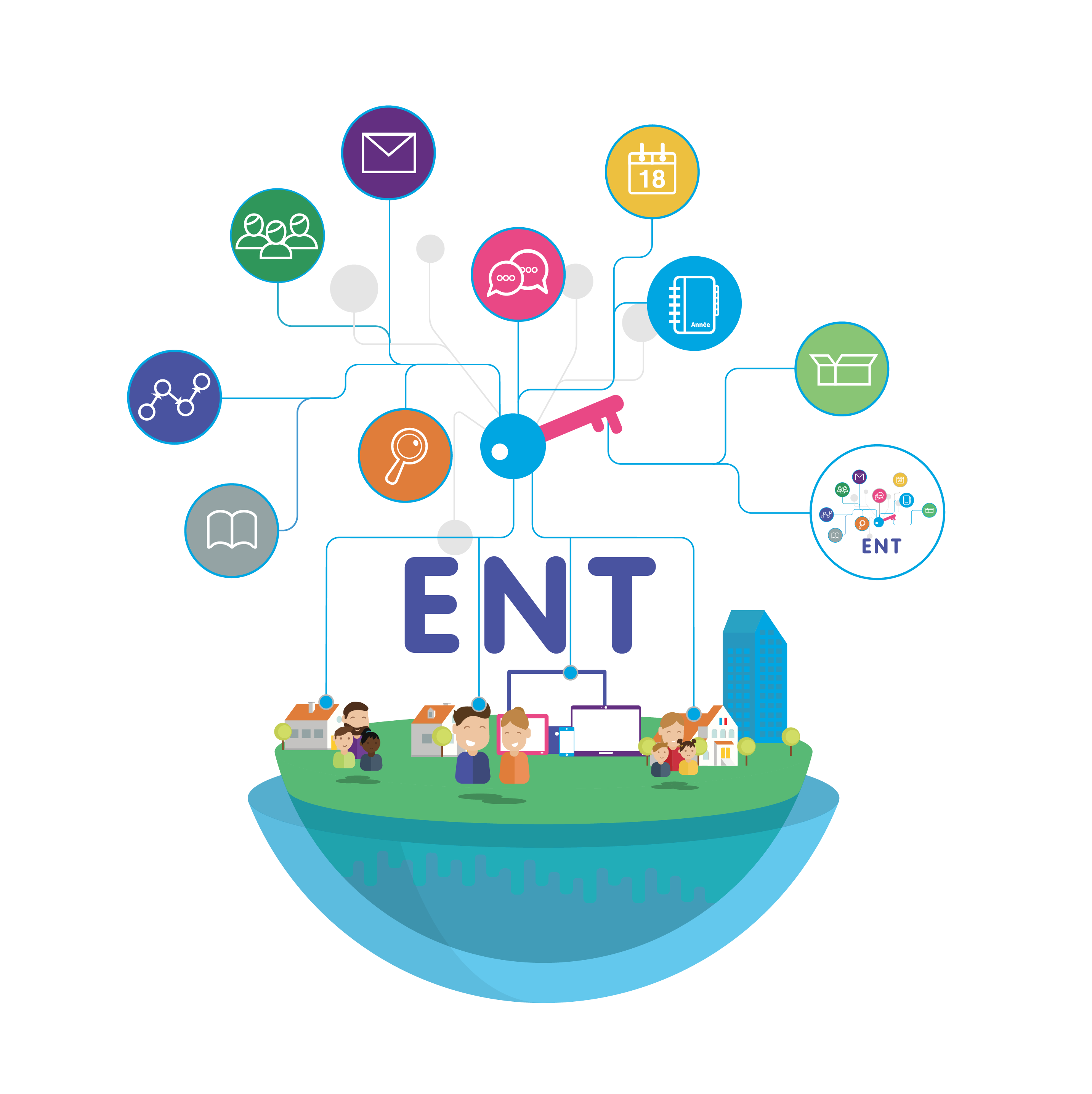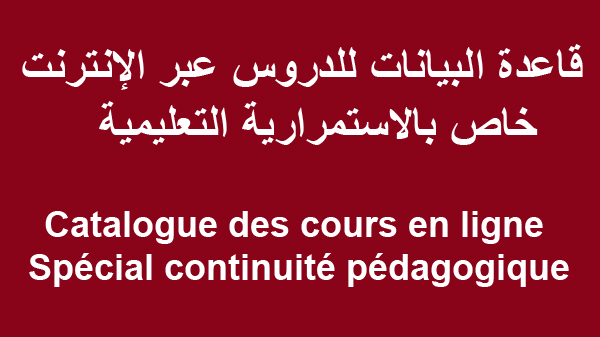Bioéthique
THE VIRTUAL LAB Confronted with the explosive popularity of online learning, researchers are seeking new ways to teach the practical skills of science.
Next-Generation Sequencing: Methodology and Application
Première Solution pour faire des spermatozoïdes artificiel (Découverte par les japonais, perspective pour une solution a la stérilité)
A Plant Evolution Revolution
Mycorrhizal Fungi Expand Contemporary Cropping Opportunities by Mike Amaranthus, Ph.D. & Larry Simpson
Soil biology has emerged over the last decade as a critical part of the knowledge base for successful and sustainable agricultural production. A key component of biology is the profound plant/mycorrhizal fungi relationship, which has enormous potential for improved management of contemporary farming systems. Although using these fungi has the potential to revolutionize agriculture they are certainly not new in terms of the evolution of plants.
Where we’ve been The fossil evidence indicates that the specialized “mycorrhiza” (meaning “fungus-root”) plant relationship dates back over 460 million years and actually played a key role in allowing plants to utilize terrestrial habitats. Without A healthy mycorrhizalinoculated organic winter wheat field in Canada.
mycorrhizal fungi, today’s crop plants might not exist, unless you are farming seaweed! For the first 75 million years that plants colonized dry Since before World War II, scientific and technological advances land, they did not have differentiated root tissue and depended in agronomy have focused primarily on the development of entirely on this symbiotic relationship with mycorrhizal fungi to
chemical and mechanical approaches to improving crop producaccess nutrients and moisture from the various and often harsh tion yields. Nutrient needs have been addressed using synthetic terrestrial environments. The root structures of plants actually fertilizers while weed suppression has been accomplished through evolved specifically as specialized attachment sites to better actillage and herbicides and plant diseases controlled using an array commodate these fungi and the efficiencies available through of chemical pesticides. More recently, modern science has begun the symbiotic “trading” of water and nutrients for sugars proto understand that in natural habitat plant roots are a complex duced by photosynthesis.
mixture of both fungi and plant that is fundamental to life on the In this symbiosis, the plant is provided better access to and planet. The vast majority of crops form an association with these uptake of nutrients and water from the soil. In return, the specialized mycorrhizal soil fungi in order to maximize perforfungus, which cannot synthesize its own nourishment, receives mance. Among the few but notable exceptions are members of its energy source in the form of carbohydrates donated by the the Brassicaceae plant family (cabbage, broccoli, cauliflower, radplant. This highly successful system continues in 90 percent of ish, turnips, canola, etc.) the Amaranthaceae plant family (beets, plant species today. spinach, chard, etc.) and the Polygonaceae plant family (rhubarb, Agricultural science has only in the last decade begun to recogbuckwheat). Virtually all other crop plants worldwide are meant nize the importance of mycorrhizal fungi in farming ecosystems. to host some form of mycorrhizal association.
Conséquence d’un changement climatique dans la région Les menaces d’une eau plus rare dans les pays arabes
Il n’y a pas que l’assèchement du sous-sol qui regorge de pétrole et gaz qui doit désormais donner à réfléchir aux dirigeants arabes, pourtant peu soucieux, eux-mêmes, des ravages de la mauvaise gouvernance dont ils sont responsables devant l’histoire.
Sahara : pourquoi il vaut mieux exploiter le soleil plutôt que l'eau
Une étude vient de le confirmer : les eaux souterraines du Sahara sont bien renouvelables. Mais de manière si infime que l'exploitation qui en est faite depuis les années 1960, et qui augmentera de manière dramatique avec l'exploitation du gaz de schiste, menace pour de bon l'or bleu du Sahara.
Publication. Mahra Bint Ahmed (écrivaine émiratie) : Krakatoa, quête de la paix intérieure
Les résurgences et les remords de Lucas, un enfant de 9 ans, fils unique d’une famille allemande aisée, passionné par la visite des volcans, sont un prétexte pour l’écrivaine émiratie de nous emmener, avec douleur, à la recherche de soi, de la paix intérieure…
L’histoire est en apparence simple : cédant aux caprices de leur enfant voulant visiter le célèbre volcan indonésien Krakatoa, les parents décèdent dans un tragique accident de la circulation. C’est le commencement d’une existence mouvementée de l’enfant. Culpabilisant, en dépit de son jeune âge, Lucas ne réussira jamais à éteindre cette douleur qui le martyrise. D’où ses questionnements relatifs à la foi, à la destinée… Un itinéraire philosophique, quasiment métaphysique, jalonné de vacillements, de chutes, de désarroi. Un cheminement, en fait, qui ne s’arrêtera pas. N’est-ce pas là toute la complexité humaine ? L’auteure, ancienne étudiante de l’université du Bahreïn, a échafaudé les tréteaux de son histoire dans un village allemand où Lucas, face à ses douloureux souvenirs, malgré l’évolution du temps, peine à effacer des images qui lui semblent indélébiles.
Paradoxalement, en choisissant Krakatoa, (une fiction de 215 pages, éditée chez la Maison arabe des sciences et des éditeurs au Liban) comme lame de fond à son livre, Mahra expulse toute sa violence intérieure pour tenter de rencontrer son destin, recouvrer la paix de son âme, la réconciliation avec soi-même. Une lutte intérieure qui s’atténuera quelque peu lorsque surgit dans la vie de Lucas, devenu adulte, un Algérien du nom Khaled qui personnifie la foi, la croyance, la délivrance d’un poids psychique longtemps porté… Khaled, un personnage fictif que Mahra a tenu à imaginer pour rendre une sorte d’hommage à la personnalité (forte) des Algériens… leur générosité, leur patience, leur foi tout simplement. Un récit époustouflant décrivant la condition humaine avec talent. A lire…
La prolifération du cancer en Algérie égalera celle des pays avancées durant les 5 prochaines années
Le président de la Société algérienne d'oncologie médicale (SAOM), le Pr. Kamel Bouzid, a affirmé que le nombre de personnes atteintes de cancer en Algérie évoluera au même rythme que celui des pays avancés durant les cinq prochaines années.
La fracturation hydraulique des schistes peut-elle compromettre les nappes d’eau du sous-sol saharien ?
Par : Mohamed Terkmani* 
La fracturation hydraulique des schistes fait l’objet de nombreuses controverses et appréhensions car elle est perçue comme étant la source de la plus grave des atteintes à l’environnement : la pollution et l’épuisement des nappes d’eau du sous-sol.
Il est donc nécessaire de clarifier les choses et dissiper les malentendus afin que chacun puisse se faire sa propre opinion à ce sujet. Tout d’abord, avant d’entrer dans le vif du sujet et afin d’en faciliter la compréhension, il convient d’apporter quelques informations de base sur les hydrocarbures de schistes et la fracturation hydraulique.
Le gaz et le pétrole de schiste (shale gas et shale oil) sont, contrairement à ceux des gisements conventionnels, contenus dans une roche argileuse compacte à perméabilité presque nulle. Les produire dans ces conditions est un défi presqu’impossible qui vient pourtant d’être relevé. Il revient pratiquement à extraire des hydrocarbures à partir d’une roche aussi compacte que du béton. De ce fait, lorsqu’un puits vertical traverse un réservoir schisteux, celui-ci ne peut que difficilement expulser (ou plutôt transpirer) les fluides qu’il emprisonne. Pour obtenir un débit rentable, il faut donc accroître la surface d’intersection puits/schistes que même un puits horizontal, avec une surface des dizaines de fois plus grande, reste lui aussi loin de satisfaire.
Il a fallu attendre l’avènement d’une percée technologique de fracturation dite multi-stage fracking qui, appliquée à un puits horizontal, a permis enfin de se rapprocher du seuil de rentabilité. Un seuil qui n’a pu finalement être franchi qu’avec l’embellie des prix du gaz d’il y a une dizaine d’années.
La technique consiste à orienter un puits horizontal dans une direction particulière afin que les fractures, toujours verticales à ces profondeurs, se forment perpendiculairement au drain horizontal. Il devient possible, de cette façon, de fracturer le puits segment après segment et d’aligner ainsi un grand nombre de fractures sur des distances kilométriques, en une sorte de brochette géante de fractures. Il en résulte alors des dizaines de fractures, plus ou moins parallèles, qui pénètrent profondément à l’intérieur du réservoir schisteux, drainant ainsi des débits et des réserves bien plus élevés, contrairement à un puits vertical où une seule fracture est possible.
L’opération implique l’injection, sous très haute pression, d’une formulation de fluides composée d’eau, d’agents de soutènement (sables ou produits similaires) et d’environ 0.5% de produits chimiques dont certains toxiques. Lors de la fracturation, le sable en suspension dans l’eau pénètre dans les fractures et s’y piège en les empêchant de se refermer sur elles-mêmes, créant de la sorte des drains à travers lesquels le gaz ou le pétrole peut s’écouler en bien plus grande quantité vers le puits. Le nombre élevé de fractures qui sont créées nécessitent d’importants volumes d’eau, allant d’environ 7 000 à 15 000 m3 d’eau par puits.
Enjeux liés aux nappes d’eau de l’Albien et aux hydrocarbures de schistes.
Il est important de rappeler à ce stade que le sous-sol saharien contient d’immenses volumes d’eau douce dans le Continental Intercalaire (CI) ainsi que dans le Continental Terminal (CT), l’essentiel se trouvant dans l’Albien qui s’étend sur plus d’un million de km2 et déborde sur plusieurs pays voisins. Une véritable mer d’eau douce à faible profondeur contenue dans des formations sablo-gréseuses de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur et d’autant plus précieuse qu’elle se trouve dans une des régions les plus arides de la planète.
Le sous-sol saharien contient également d’immenses réserves d’hydrocarbures dans les couches beaucoup plus profondes du Trias et du Paléozoïque. Mais des réserves en voie d’épuisement alors que l’économie du pays reste fortement tributaire de cette ressource qui représente près de 98% de ses exportations. Et voilà qu’on nous annonce que cette rente risque de disparaître bientôt, autour de 2020 pour le pétrole et autour de 2030 pour le gaz, alors que nous ne pouvons pas nous en passer car nous ne sommes pas prêts pour l’après-pétrole.
À ces réserves viennent maintenant s’ajouter de vastes réserves non conventionnelles que sont les hydrocarbures de schistes, potentiellement bien plus importantes. Or c’est précisément autour de ces dates de fin de rente, et pas avant, que les hydrocarbures de schistes pourraient connaître un début de production s’ils s’avèrent exploitables. Ce serait là une chance inespérée qui tomberait au moment où on en aurait le plus besoin et sans laquelle le passage vers une économie d’après-pétrole serait beaucoup plus problématique avec une population qui avoisinera alors les 50 millions.
Nous nous trouvons donc confrontés, si risque de pollution il y a, au dilemme d’avoir à sacrifier une des deux richesses inestimables et indispensables du sous-sol saharien : l’aquifère de l’Albien ou les hydrocarbures de schistes. Par conséquent, la question fondamentale qui se pose à ce point est de savoir s’il y a vraiment risque de pollution. Dans l’affirmative, il faudrait interdire sans hésiter l’exploitation des hydrocarbures de schistes pour préserver les nappes aquifères. Dans la négative, il serait possible de tirer profit de ces deux richesses qui deviendraient complémentaires et non exclusives l’une de l’autre. Sont-elles incompatibles ? Ou au contraire est-il possible de ménager le chou et la chèvre afin de tirer profit des deux ?
L’enjeu est énorme et nous interpelle pour répondre à la préoccupation centrale de savoir si la fracturation hydraulique peut vraiment polluer et épuiser les aquifères.
La fracturation hydraulique peut-elle polluer les aquifères de l’Albien ?
L’argument principal de ceux qui s’opposent au développement des hydrocarbures de schistes est que les fluides de fracturation et les hydrocarbures peuvent, au terme de l’opération, remonter à travers les formations de subsurface jusqu’au niveau de l’Albien et le polluer irrémédiablement. Et même que, dans des cas extrêmes, les fractures elles-mêmes pourraient remonter jusqu’à ces nappes, les pénétrer et les polluer directement.
Or cela est quasiment impossible pour plusieurs raisons. D’abord parce que la distance séparant l’extrémité supérieure des fractures et la base de l’Albien peut atteindre les 2 kilomètres. Qui plus est, cette séparation est constituée d’un empilement de formations lithologiques dont la plupart sont imperméables. C’est le cas des argiles, du sel, de l’anhydrite et des carbonates se présentant sous forme d’une multitude de bancs massifs d’épaisseur métrique à décamétrique absolument étanches sans parler d’une infinité de laminassions de même nature. Ces formations, qui se répètent en une infinité d’intercalations imperméables jusqu’à la base de l’aquifère et même au-delà jusqu’en surface, se comportent comme autant de barrières infranchissables s’opposant à toute migration de fluides, artificiels ou naturels, vers la surface.
On peut même imaginer le cas extrême et hautement improbable d’une fracture se propageant accidentellement à travers ces formations ou par l’intermédiaire d’une faille, jusqu’à pénétrer directement l’aquifère près de deux kilomètres plus haut. Si ce cas impensable pouvait se produire, seul l’extrême bout de la fracture y pénètrerait, ce qui signifie qu’une quantité négligeable de fluide de fracturation y parviendrait.
En outre, lors du dégorgement des puits qui suit toujours les opérations de fracturation, l’aquifère serait lui aussi aspiré et repousserait cette quantité négligeable de fluides polluants vers le puits. Une pareille fracture, ou faille, ne manquera d’ailleurs pas de se colmater rapidement au niveau des bancs d’argile et de sel, relativement plastiques et fluents aux pressions et températures auxquelles ils sont soumis, et tout mouvement de fluides cessera.
En fait, les accidents de cette nature sont pratiquement impossibles grâce à la panoplie de modèles numériques permettant de prévoir, entre autres, la hauteur des fractures avec une bonne précision et d’éviter toute anomalie éventuelle. Sans parler de la microsismique qui permet de suivre en temps réel l’évolution de tous les paramètres de la fracture (en particulier la hauteur) et de prendre pendant l’opération toute mesure d’urgence ou d’arrêt qui s’impose.
On pourra même se passer de ces techniques dans la plus grande partie du bassin saharien car il s’y trouve, au niveau du Trias salifère, une épaisse couche de sel massif de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur située à mi-distance entre les formations de schiste et l’Albien. Cette couche forme une barrière absolument infranchissable à toute fracture quelles que soient ses dimensions car celle-ci viendrait tout simplement y mourir étouffée par le sel.
Enfin, il existe un argument géologique de poids prouvant qu’aucune fracture ou migration de fluides ne peut, ni n’a pu, atteindre l’Albien. En effet, si tel était le cas, les hydrocarbures auraient pu migrer vers la surface au cours des temps géologiques, au lieu de rester piégés là où ils sont, et aujourd’hui on trouverait des gisements d’hydrocarbures dans l’Albien lui-même. Il en aurait été de même pour les eaux saturées en sel des aquifères profonds qui auraient transformé la nappe d’eau douce de l’Albien en mer d’eau salée. Tout se passe comme si mère nature s’était elle aussi mise de la partie pour protéger jalousement ses aquifères en empêchant les intrus les plus obstinés de s’y rapprocher.
Pour conclure ce chapitre, nous pouvons dire que les risques de pollution des nappes aquifères par les fluides de fracturation sont quasiment nuls. Et ces risques pourraient être rapprochés encore d’avantage du risque zéro par les agences de régulation en imposant une distance minimum de sécurité, à définir pour chaque secteur, entre l’extrémité supérieure de la fracture et la base de l’Albien. Par exemple 500 m ou plus.
Tous les secteurs où cette distance serait inférieure au minimum requis devraient tout simplement être déclarés zones interdites à la fracturation hydraulique en attendant que des techniques plus sûres soient développées. On pourra d’ailleurs se passer facilement de ces zones vu l’immensité du domaine minier algérien.
Enfin, tout ce qui vient d’être dit ne concerne, bien entendu, que la fracturation hydraulique. Pour le reste, l’exploitation des hydrocarbures de schistes est, malheureusement, tout aussi polluante que celle des hydrocarbures conventionnels mais ni plus ni moins. Nous y reviendrons.
Fracturation hydraulique et volumes d’eau requis
Un des gros problèmes de la fracturation hydraulique multi-stage réside dans les énormes volumes d’eau qui doivent être mobilisés pour les besoins de l’opération. Chaque puits en consomme environ 7 000 à 15 000 m3 d’où une forte réticence devant un usage perçu comme un gaspillage dans une région en manque d’eau.
Mais au fait manque-t-il de l’eau dans le bassin saharien ?
D’après les évaluations de l’ANRH (Agence nationale des ressources hydrauliques), les réserves d’eau du bassin saharien se situent entre 40 000 et 50 000 milliards de m3. Quant aux capacités de production, elles sont estimées à 6 535 millions de m3/an avec un soutirage actuel de 2 748 millions de m3/an pour les besoins agricoles, industriels et autres, ce qui laisse un surplus de 4 070 millions de m3/an pour des activités supplémentaires.
Sur la base de 15 000 m3 par puits, il faudra 15 millions de m3 pour 1000 puits et 150 millions de m3 pour 10 000 puits, soit respectivement 0,00003% et 0,0003% des réserves en place. S’ils sont forés à raison de 200 puits par an, la consommation totale s’élèvera à 3 millions de m3/an, ce qui représente 0,073% du surplus disponible annuellement.
M. T .
Ingénieur, ancien directeur à Sonatrach
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.