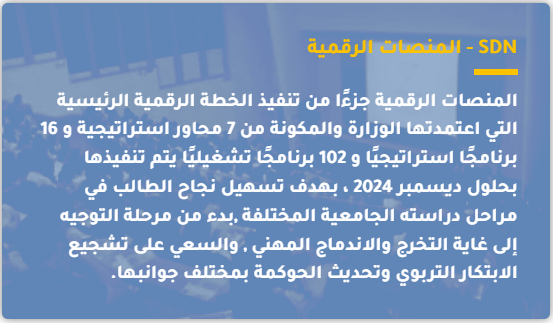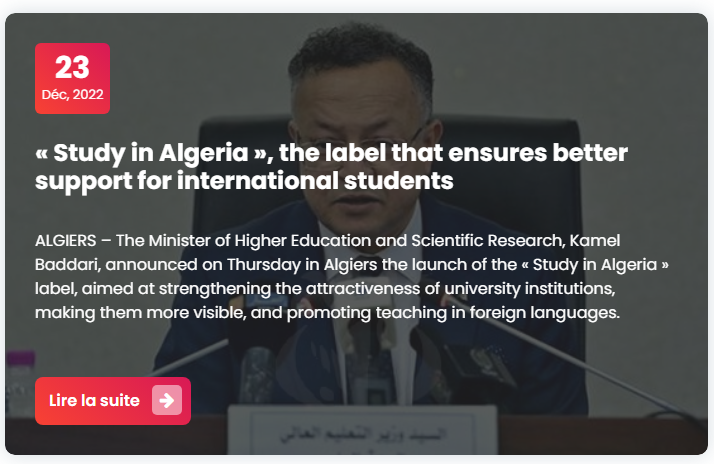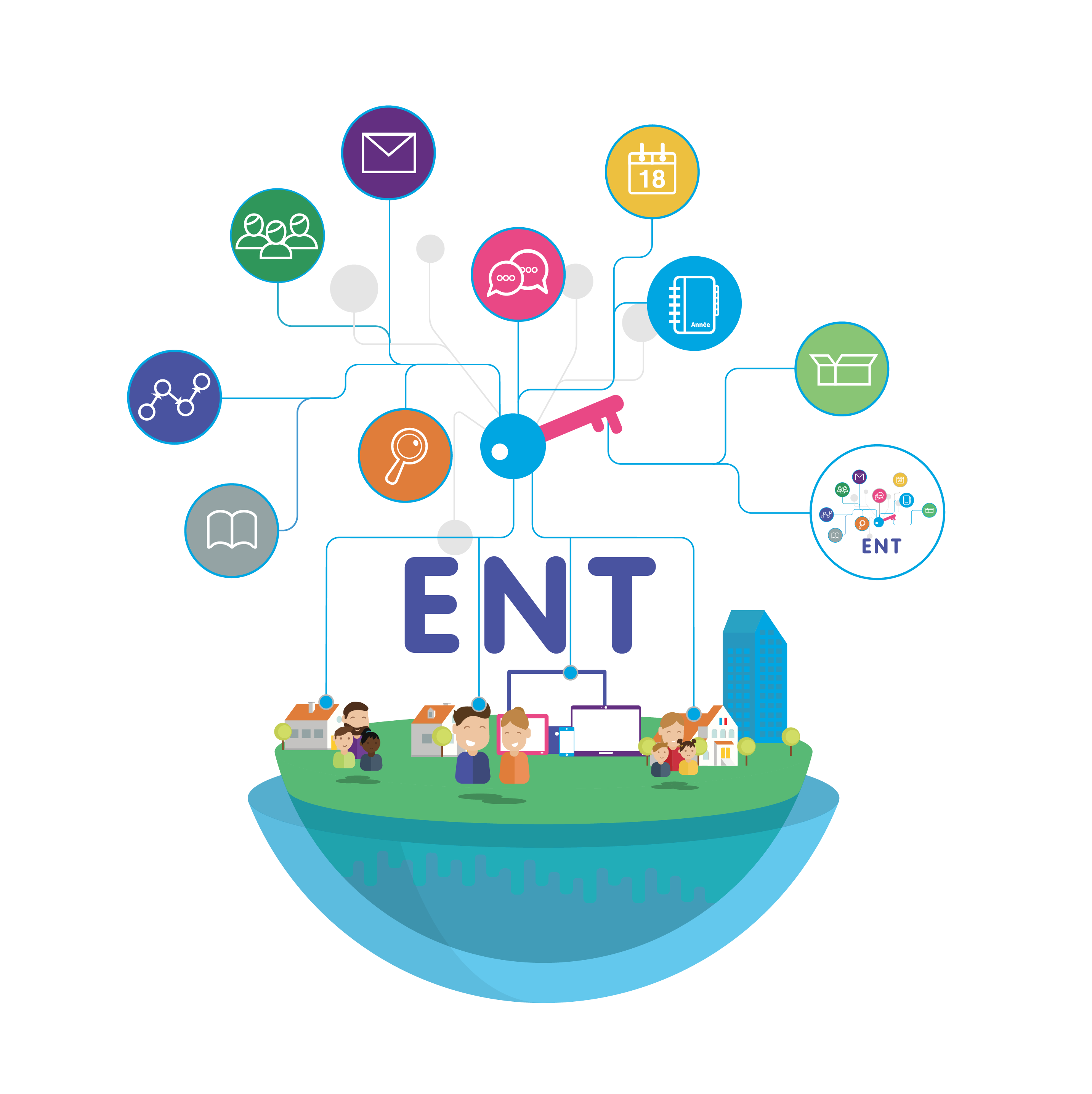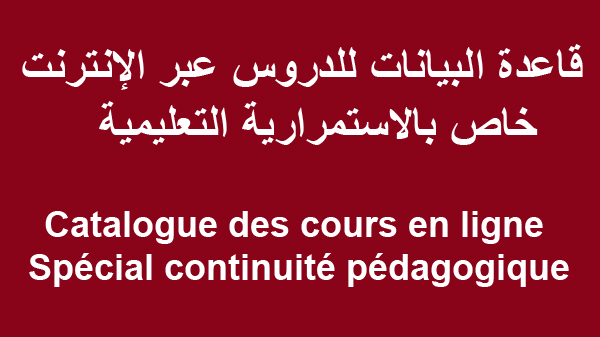Appel à candidature bourse ERASMUS+ Mobilité Internationale de crédits
إعلان عن يوم تكويني لفائدة طلبة السنة أولى ماستر عن بعد: إدارة محلية العام الجامعي 2017/2018
coopération algéro-britannique
Profas b+ 2018-2019 RDV pour le test TCF
Dans le cadre du profas b+ 2018-2019 ci joint un tableau relatif a la prise de RDV pour le test TCF
pour les doctorants candidats au PROFAS B+
| PROFAS B+ 2018 / Dates de disponibilité TCF SO | |
| IF Alger |
Samedi 24 février 2018 5 créneaux horaires : 8h00, 10h30, 13h30, 16h00, 18h00 total : 260 places les étudiants s'inscrivent à l'Institut français à partir de ce dimanche 18 février et au plus tard mercredi 21 février 2018 |
| IF Oran | pas encore de retour |
| IF Annaba | pas encore de retour |
| IF Tlemcen |
Les doctorants doivent s'inscrire au plus vite et bien préciser lors de leur inscription qu'ils candidatent au PROFAS B+ 2018 Les agents leur donneront un rendez-vous avant le 8 mars 2018 |
| IF Constantine |
Dimanche 4 mars 2018 3 créneaux : 9h, 12h, 14h total : 84 places |
CRÉATHON 2018 - AUF
CRÉATHON 2018 - AUF
https://www.auf.org/europe-oue
formation entrepreneuriat
Programme PROFAS B+ 2018/2019
Programme PROFAS B+ 2018/2019
CRUEst
Fiche de controle de dossier du candidat PROFAS B + 2016-2017
MESRS
Attestation de non-activite_PROFAS B+_2018
Attestation de non-benefice formation residentielle_PROFAS B+_2018
Attestation d'engagement_PROFAS B+_2018
Engagement convention de cotutelle_PROFAS B+_2018
Formulaire de candidature_PROFAS B+_2018
Lettre d'accueil_pour co-encadrement_PROFAS B+_2018