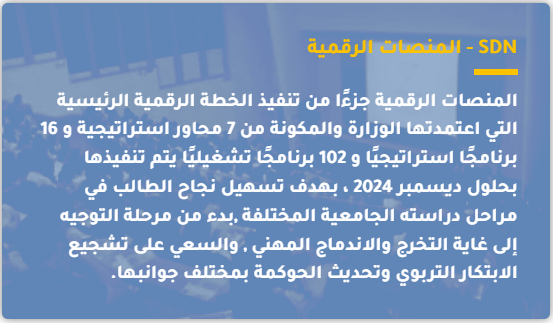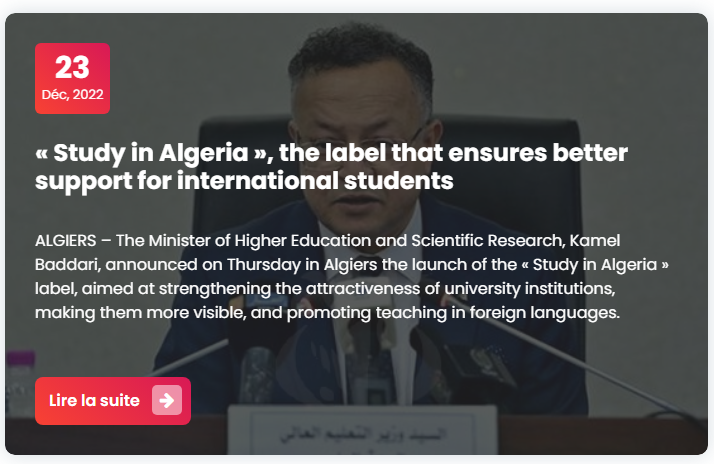- Détails
- Écrit par Redaction Web 1
- Catégorie : La Revue de Presse
- Publication : 4 mars 2015
- Affichages : 2588
Par Mohaled Lakhdar Maougal(*)
Il nous faudrait, à cette triste occasion du grand départ ad vitam æternam de l’académicienne consacrée à titre d’étrangère Assia Djebar, encenser ceux et celles qui, leur vie durant, se sont battus avec conviction et acharnement contre tous genres de flagorneries. Mais il y a mieux encore à faire et c’est de suivre l'exemplaire itinéraire iconoclaste et courageux de ces justes.
La disparition récente d’Assia Djebar, suivie de peu par celle de son ex-second époux, le poète Malek Alloula, vient de donner l'occasion aux Algériens de s'arrêter un moment sur une actualité autre que celle mortifère du criminel projet d'empoisonnement «pollutionnaire» qui menace nos concitoyens du Sud. Voici qu’un grand tapage médiatique se déroule encore (funérailles quasi nationales, émissions multiples, bientôt des projets de colloques pour une écrivaine et sans doute un poète et essayiste, conjointement ignorés longtemps et réduits parfois à des débats caverneux de chauves-souris).Tout cela à mon sens porte une atteinte grave et fondamentale à la «sira» éthique et politique de cette romancière et intellectuelle rebelle qui aura compté comme exclusivité dans le quarteron des grands écrivains fondateurs, Mouloud Mammeri, Mohammed Dib, Kateb Yacine et Jean Sénac.
Mes amis des médias (TV, radio, presse écrite) m'ayant sollicité pour dire mon mot, j'ai décidé d'apporter ma contribution à la lecture de ce cas d'espèce original, mais en m'inscrivant dans l'esprit et la lettre de la mission que s'était donnée Assia Djebar de faire vivre, entretenir et survivre l'esprit iconoclaste qui a donné à notre littérature naissante des années 1950 et 1960 ses lettres de noblesse et de grandeur.
Assia Djebar, une «francophonophile» sans hypocrisie, sans complexe
Polygraphe et militante, contrairement aux assertions contrites et chagrines de certaines de ses commentatrices, Assia Djebar aura assumé pleinement, dès les premières années de l’indépendance de l’Algérie et à la fin des années soixante, son inscription dans la francophonie au moment où, en Algérie, une préfabriquée guerre linguistique xénophobe et réactionnaire, sous forme d’invasion arabophile, voulait éradiquer tout ce qui pouvait, voire risquait de «polluer» l'identité algérienne «arabo-islamique». Sa décision volontaire, souveraine et réfléchie de se replier sur la France aura été explicitement exprimée dans cette déclaration qu'elle a faite : «J'écris, comme tant d'autres femmes écrivains algériennes, avec un sentiment d'urgence, contre la régression et la misogynie.» (sic).
Vivant depuis les années soixante en France et échappant de ce fait à la chape totalitaire de l’Etat-parti unique qui comprima le pays jusqu’à la révolte de 1988, Assia Djebar fera le saut et assumera courageusement de transformer sa francophonie volontaire en une culturelle et civilisationnelle francophonophilie (l’amour de la langue française). C'est sur ces deux piliers de son «métier à tisser et à coudre» qu’Assia Djebar va entreprendre une carrière d'écrivaine, de dramaturge, de poétesse et de cinéaste. C'est sur ce programme même qu'il serait le plus productif et le plus incisif d’approcher son œuvre depuis la Soif (roman fortement inspiré de l’écriture militante et féministe de Françoise Sagan, 1957) jusqu'à son dernier roman publié, Nulle part dans la maison de mon père, 2007).
Or, que nous révèle cette intentionnalité programmatique sur le projet djebarien ? Explique-t-elle la décision d’Assia Djebar de s'éloigner de l'Algérie dès 1967-1968 ? Explique-t-elle sa décision d’opter culturellement et civilisationnellement pour Voltaire et Diderot plutôt que pour Abou Othmane Ibn Bahr El Djahedh et Naguib Mahfouz ? Ce choix sera couronné par les institutions françaises par l’octroi à la romancière de la Légion d’honneur, du titre de commandeur des arts et des lettres ainsi que par le couronnement de sa carrière de romancière avec un statut d’«immortelle» académicienne. Et c’est justice.
Assia Djebar aura toujours fait preuve d’esprit d’indépendance et d’autonomie par rapport aux différents pouvoirs politiques et idéologiques qui se sont succédé dans notre pays depuis 1962 à ce jour. C’est une constance qui mérite d’être relevée, saluée, soulignée. Je ne puis m’empêcher de rappeler pour autant qu’elle n’avait pas répondu aux sollicitations de ce même pouvoir quand, en 1999, des «intellectuels» et artistes avaient été approchés par les officiels qui nous préparaient les mandats successifs et désastreux que le nouveau millénaire nous préparait avec la pièce rapportée du Proche-Orient, comme elle ne participera pas à la campagne de récolte de signatures orchestrée par El Mouradia pour soutenir la candidature du chef de l’Etat algérien au prix Nobel, lui qui aura réintroduit avec une certaine «décomplexitisation» l’usage administratif et quasi officiel de la langue française depuis 1999.
Avertie ou en alerte, Assia Djebar aura fait l’économie de l’expérience affligeante de mon amie la professeure Latifa Benmansour qui s’était emballée pour le candidat de 1999 et qui aura vite déchanté en l’affligeant de tous les sobriquets, surtout après l’épisode lamentable de l’incident à l’université d’Oran Senia quand le candidat s’était accroché violemment avec un enseignant récalcitrant.
Assia Djebar a construit toute son œuvre sur un paradigme solide et inusable : la dualité répulsive de «la régression et de la misogynie». Car tel est le substrat comportemental culturel qui aura été inoculé à notre pays par le greffon oriental d’une culture décadente que même la colonisation prétendument civilisatrice n’aura pas réussi à déconstruire. Assia Djebar le soulignera finement et explicitement dans certains de ses ouvrages.
Sa délicieuse œuvre romanesque débute par une espèce de pastiche inspiré de la littérature féministe militante sur fond des années de la guerre de décolonisation algéro-française. Elle publiera la Soif sous pseudonyme (Assia Djebar) pour ni choquer ni froisser sa famille en Algérie, voire pour ne pas contrarier le cours de la littérature algérienne engagée et militante dans le chemin de l’émancipation nationale. En fait, instruite par l’histoire qu’elle a choisie comme discipline d’étude, de travail et de recherche, elle prend la précaution de ne pas rééditer la crise de 1947 (la crise dite berbériste) que Messali avait provoquée pour vider le mouvement national des éléments progressistes et démocrates qui lui contestaient sa ligne autoritaire encadrée par l’islamisme agitateur du Congrès de Jérusalem (voir le livre de Rachid Ali Yahia sur la crise berbériste). Une revendication féministe en pleine guerre d’Algérie aurait été fatale à l’écrivaine si elle avait signé le livre de son nom véritable. Cela aurait provoqué une curée — Mohamed Cherif Sahli et Mostefa Lacheraf venaient d’exécuter politiquement Mouloud Mammeri avec l’affaire de la Colline oubliée (1953). C’est alors qu’elle va glisser dans ses ouvrages futurs romanesques et théâtraux, cette condition féminine qui accompagnera ses témoignages et ses réflexions sur les femmes algériennes du temps de la guerre (les Impatients -1958 ; les Enfants du nouveau monde - 1962 ; les Alouettes naïves - 1967 et enfin Rouge l’aube -1969)
Cette production romanesque sera suivie d’un long silence de près de vingt ans (1967-1985), que mettra à profit cette femme en gésine d’un projet revendicatif égalitariste pour porter la parole et la gestuelle féminines à travers les expressions artistiques (théâtre, peinture, cinéma), d’abord à l’écran dans l’espoir qu’elle sera mieux entendue et finement perçue. En 1978, Assia Djebar se présente au Festival international de Carthage avec un film, Nouba des femmes du mont Chenoua. Sa déception est alors à son comble.
Le film n’est même pas programmé au seul pays maghrébin où les femmes semblaient avoir joui d’un statut qui pouvait faire reculer «la régression et la misogynie». Un talentueux et courageux journaliste algérien fera connaître ses acrimonies (Kheireddine Ameyar in Agérie Actualité, 1978). Le film sera pourtant primé au Festival de Venise en 1979.
Ce sera ensuite dans une écriture hybride d’un essai sur fond pictural, Femmes d’Alger dans leur appartement -1980, suivi d’un second essai hybride, encore une fois, mais sur fond musical d’opéra, la Zerda ou le chant de l’oubli. Ce n’est que près de vingt années plus tard, qu’Assia Djebar signera de nouveau un roman qui change la perspective de son programme éditorial influencé par l’intermède de l’écriture hybride artistique (L’amour, la fantasia -1985). Le côté artistique et professionnel prend alors souche dans le projet éditorial. Sans doute la rationalité devait-elle prendre le pas sur l’émotion. L’intégration des lectures et des références témoigne d’un souci de prendre distance avec l’affect et le subjectivisme. Picasso et Delacroix sont inscrits dans les arcanes de la romancière qui a capitalisé son expérience artistique en la mariant à sa veine romanesque. L’amour, la fantasia est une rupture dans l’écriture avec un nouveau programme éditorial. Prenant quelques reculs avec le réel circonstanciel, Assia Djebar se lance dans une nouvelle expédition. Arracher une place de choix dans le Panthéon de la littérature francophone universelle, quand l’Algérienne resta dominée jusqu’alors par les ancêtres fondateurs (Mammeri, Dib, Kateb, Sénac). Telle semble avoir été sa détermination.
C’est ainsi que se concrétisera la transition. La guerre de libération qui n’a pas changé le statut de la femme bien qu’elle ait vu la participation de cette dernière à tous les niveaux de la lutte va progressivement céder la place à une nouvelle lutte pour une nouvelle émancipation, celle de la femme citoyenne. Lutte qui sera encore plus difficile car le monde né avec les indépendances n’a rien produit de transformation radicalement ni essentiellement moderniste, les femmes ayant été reprogrammées pour «retourner à leurs couscoussiers», dira un historien avisé. Ce n’est pas alors, mais pas du tout un hasard, si la trilogie qui prend la relève de l’intermède artistique essayiste s’annonce en rapport synergique avec le réel d’un pays qui tourne le dos à ses martyrs en reniant leurs espérances. L’amour, la fantasia met en perspective et la colonisation et le vécu qui se mélangent dans les abysses des mémoires édifiées sur les deux territorialités du monde cauchemardesque du passé et de l’univers incertain et inquiétant de l’avenir. Sordide sera la prison des femmes, immense sera le cimetière des victimes du terrorisme.
La décennie de 1985 à 1995 voit se succéder des productions d’un ensemble trilogique, L’amour, la fantasia - 1985 ; Ombre sultane -1987 ; Vaste est la prison -1995 ; trilogie entrecoupée par deux romans-essais, Loin de Médine -1991 et Le blanc d’Algérie -1995. A croire que les femmes d’Alger sorties de leur appartement par effraction auront rendu un soupçon d’hommage à l’impétueux peintre anarchiste espagnol Picasso, l’auteur de Guernica et de Djemila, l’Algérienne qui pleure pour corriger l’ineptie du harem colonial exposé par le peintre Eugène Delacroix. Ce travail de déconstruction et de dénonciation de la colonisation par Assia Djebar est ainsi accompagné par la verve colorée et impétueuse de l’anarchiste peintre espagnol qui avait, dès les années 1950, apporté son soutien à la cause algérienne par ce magnifique tableau de la Femme qui pleure. L’amour, la fantasia relate l’inextricabilité de deux mémoires en lutte et en synergie d’interpénétration. La colonisation de l’Algérie au XIXe siècle, entreprise de démolition et de destruction, de meurtres et de spoliation, débouche, un siècle plus tard, sur l’école républicaine laïque, gratuite et obligatoire ouverte aux petites filles indigènes que leur père, instituteur lui-même, accompagne à l’école. L’école républicaine suffisait- elle à «blanchir» la sinistre entreprise coloniale monarchiste ? Sera-t-elle absoute pour avoir permis l’émergence de grands écrivains et écrivaines ? Le thème n’est pas original, mais son traitement réarticule la dimension autant que la fonction émotionnelles. Kateb Yacine, sans pourfendre l’école francophone, l’accuse de dévorer tel un loup les petits indigènes. A cette école coloniale, Kateb opposera l’école du soir du FLN dans les cellules des prisonniers, et ce, dans son théâtre qui donne à méditer sur un Cadavre encerclé -1954 - en un Polygone étoilé -1966. Mais le plus incisif contre cette entreprise de «dépersonnalisation» sera Malek Haddad qui, au lendemain de l’indépendance, rangera définitivement sa plume «sergent major» dans son pupitre.
Il n’y a qu’auprès de Mouloud Feraoun et de sa littérature qu’Assia Djebar trouvera un devancier du même acabit et avec la même intensité émotionnelle. Pour le second roman de cette seconde trilogie, Ombre sultane, c’est la féminité en épreuve, voire en détresse qui se substitue à l’enthousiasme émotionnel de l’accompagnement paternel à l’école. La petite écolière cède la place à Isma la jeune femme cultivée, divorcée et remplacée auprès de son époux par Hajila, une paysanne mariée «sans son accord». C’est alors que la question citoyenne féminine brise le mur du silence et brave l’ostracisme. Cette transition de la domination coloniale à la nécessaire émancipation nationale et citoyenne va se construire sur un ensemble référentiel méditerranéen qui aura longtemps traduit les prométhéennes batailles des femmes contre ce statut tragique qui leur aura été imposé depuis les temps les plus reculés et que le théâtre grec, particulièrement, aura illustré depuis Plaute et Aristophane. Cette inscription de la tragédie féminine dans le texte romanesque djebarien, pour avoir été tardive, aura perdu tout de même son originalité.
En effet, un génotexte (je préfère le concept de Jacques Berque qui parle de «génomémoire») du tragique féminin s’est mis en perspective dès les premières années de l’indépendance avec des textes fort explicites et parfois violents comme ceux de Fadila Merabet, côté féminin singulier pour bien longtemps encore, et de Rachid Boudjedra, côté masculin pluriel de manière précoce, avec l’entrée en lice des précurseurs de la littérature algérienne d’expression arabophone, à l’instar de Abdelhamid Benhedouga, Merzak Baktache et Djilali Khellas.
Il semble dès lors que le programme éditorial d’Assia Djebar ait accusé un tournant décisif avec l’émergence d’un nouveau paradigme : le féminisme citoyen prenant chez elle et dans sa production le pas sur le féminisme identitaire. Ainsi triomphera dans son nouveau projet éditorial le nombre pluriel sur le genre singulier. Diderot triomphant de Sade. Paradoxalement c’est sur un texte iconoclaste, que cette révolution profonde se réalise. La femme qui pleure sur son sort de semi-émancipée tout en méditant sur son engagement national patriotique efface subrepticement la combattante ou plutôt la supplétive du maquis des seigneurs de guerre.
L’année 1995 voit coup sur coup la publication de deux ouvrages par Assia Djebar. Vaste est la prison, un volume de 351 pages, publié chez Albin Michel et Le blanc de l’Algérie qui ne compte pas moins de 279 pages chez le même éditeur. Pas si étrange la contiguïté ni la concomitance. Programmées ? Il faut se résoudre à le croire ! La prison et le cimetière sont devenus les lieux de prédilection des Algériens et des Algériennes. La prison c’est une mort en sursis, le cimetière une mort programmée, assurée. Pour la femme, la sordide prison, c’est le lieu de la claustration à géométrie variable, le pays, la tribu, la famille où se fait et se défait toute généalogie féminine. Une grand-mère mariée nubile de 14 ans à un vieillard, une mère éplorée qui, durant la guerre d’indépendance, traverse la Méditerranée pour aller rendre visite à son fils incarcéré en France, une adolescente partagée entre deux cultures qui se retrouve tisseuse de mots et de fragments de mémoire travaillée à l’aune des passions contenues et parcimonieusement avouées à travers les sinuosités d’une langue énigmatiquement tatouée comme une mémoire ballottée par les souvenirs de tendresse et de douleur. Devenue narratrice adulte et diseuse de bonne aventure, l’adolescente d’autrefois redonne vie à ses amis, des moments de lecture qui lui ont tenu compagnie dans l’intimité du boudoir : Camus, Amrouche, Fanon, Sénac, Mammeri, Kateb, Djaout qui venait à peine d’être assassiné à Alger. C’est sans doute ce dernier qui réveille le cortège qui s’ébranle pour faire la balade des cimetières, ces lieux de cette mort qui avait obnubilé les fondateurs et qui donne à l’écrivaine l’occasion de revenir sur la guerre devenue civile et fratricide avec l’indépendance du pays. Cette évocation, in absentia, à partir de la Californie symbolisant le Nouveau Monde, n’est pas sans poser quelques questions et observations.
Rappeler le monde des morts à partir du «Far West», espace génocidaire si besoin est de le rappeler, est une fine subtilité que la romancière se paie en clin d’œil. Et quelle symbolique ! Les «chers disparus», morts de l’histoire culturelle de l’Algérie dont il est question, sont des enfants de la terre algérienne, y compris le petit «pied-noir» (de Belcourt d’Alger et non l’un des génocidés des montagnes des Appalaches aux Etats-Unis). Le blanc de l’Algérie (1995), rare œuvre littéraire qui s’attaque à chaud et à vif au terrorisme et à la guerre, réajuste l’image de l’écrivaine qui gagne en notoriété et en courage.
La publication concomitante de ce roman-essai avec un autre titre très évocateur, Vaste est la prison, permettra d’imposer une lecture de ce livre sur le génocide comme un rappel de la barbarie qui a pris dans les expéditions coloniales ses premiers élans pour se perpétuer jusqu’à l’actualité la plus tragique.
Il est pourtant un texte fort problématique que publiera Assia Djebar pour couper cet intermède génocidaire de la décennie (1989-1999). Texte de conjoncture et de participation à une entreprise citoyenne et libertaire, Loin de Médine (1991) annonce un nouveau programme éditorial. Le réveil de l’islam politique en Iran, au Soudan et en Afghanistan (1980) qui a précédé de peu la chute de l’empire soviétique (1989) ouvre ainsi une perspective de réflexion et de travail sur le champ éditorial qui se focalise sur les réalités du sursaut turbulent post-indépendance dans tout le monde de la périphérie post-coloniale. La littérature d’Assia Djebar en porte-t-elle des traces ? C’est que le modèle citoyen vient de loin et de manière insolite bien que fort habilement reconstruit à travers une trame romanesque qui s’impose l’économie de la rigueur de l’histoire et se passe de toute référence.
C’est aux origines mêmes de la nouvelle civilisation née avec la troisième grande religion révélée – l’islam — que prend ses sources et inspirations la reconstruction de la logique de légitimation. Assia Djebar semble être en synergie avec l’actualité qui voit monter dans tous les pays de religion musulmane un profond et impétueux mouvement de reconsidération de la légitimité des pouvoirs gestionnaires de l’Etat et des communautés de fidèles. Nouvelle citoyenneté ? Nouveau contrat social ou plutôt nouveau contrat communautaire ? Il n’est pas inutile ni interdit de s’interroger sur ce nouveau paradigme. Et si c’était l’aube d’une ère nouvelle pour une nouvelle conception du lien social symbolique ?
Le syndrome linguistique d’Esope
Loin de Médine semble avoir grillé les doigts de la romancière. Le sujet sera abandonné, classé, archivé, enterré. La guerre du foulard en France focalise l’attention des médias, et Assia Djebar a entre-temps appris que le hidjab avait été, par «sunna», imposé par le Prophète Mohamed Ibn Abdellah à ses épouses, rien qu’à ses épouses. Le piège de la polémique menaçait dès lors toute référence à cette féminité singulière de la périphérie de la prophétie. L’affaire du Da Vinci Code venait de verser dans le monde éditorial un ouvrage sulfureux de grande proximité avec la thématique sensible. Assia Djebar esquive avec délicatesse et prudence. Le sujet est abandonné, classé. A défaut de pérorer sur la femme sinon pour revenir au substrat de l’émancipation identitaire post-coloniale, Assia Djebar renoue avec la mémoire douloureuse de la guerre qui couvre de ses souvenirs les horreurs terroristes de la décennie noire. S’y ajoute dès lors un nouvel ingrédient d’identification socioculturelle dans la conjoncture du soulèvement de la Kabylie des arouch (2000). Cela commence prématurément avec un recueil de nouvelles nostalgiques et émotionnellement pathétiques.
La romancière tisse un nouvel écheveau mémoriel à base d’identité ethnolinguistique qui a pour référent spatial une ville métropole, Oran, où revient le thème de la quête des origines sur fond de terrorisme et de violence qui déchirent l’Algérie. Ce retour au pays des ancêtres sera une occasion pour la romancière de poser la question épidermique sur la vie et la mort des langues. Oran, langue morte, publié en 1997, à Paris, puis en 2001 à Montréal, sera suivi immédiatement par un texte «patchwork», une collection de conférences entre 1982 et 1998, Ces voix qui m’assiègent chez Albin Michel, à Paris. Cimetière sans sépulture ou prison à perpétuité, tel sera le lot de la femme et la romancière commence à le vivre en sa chair meurtrie. Après l’évacuation des évocations meurtrières ravivées par le terrorisme criminel des années de plomb — 1991 à 2002 —, s’impose le spectre de Zoulikha, la femme enlevée, torturée et disparue. La violence conjoncturelle ne cesse de jeter des passerelles entre la guerre d’hier et le terrorisme d’aujourd’hui.
La nouvelle décennie (2000-2010) qui ouvre un nouveau siècle (XXIe siècle) et un nouveau millénaire (3e) est lancée après un constat de tohu-bohu (Ces voix qui m’assiègent, 1999) espèce de plongée dans les abysses de la mémoire écrivaine pressentant tragiquement le dépérissement de l’outil de travail, ici la langue francophone. Mais un sursaut se réalise.
La langue française renaît en Algérie dans les discours officiels et confortant la langue éditoriale. Mieux encore, un accord intergouvernemental programme une année algérienne en France qui n’aura pas la suite escomptée en réciprocité. Paradoxalement, c’est en cette année même de l’Algérie en France, qu’Assia Djebar publie un roman-épitaphe de la langue française, La disparition de la langue française chez Albin Michel, 2003. Berkane, Un émigré, revient à La Casbah de ses origines et celle de Pépé le Moko. Vingt ans après, il ne reconnaît plus son pays. Cet amer constat se tisse sur une trame romanesque qui semble l’avoir prédestiné. Un souvenir de lecture et un puissant sentiment de culpabilité se profilent derrière ce constat et sème un trouble, voire une ambiguïté.
Le spectre du commandeur Malek Haddad, pourfendeur de la francophonie, se présente de nouveau post-mortem. Mais l’originalité du traitement de ce traumatisme c’est d’être construit sur une intrigue romanesque amoureuse qui laisse légitimement penser à une intertextualisation très forte frisant le plagiat. Les nuits de Strasbourg (Actes Sud, 1997 et 2003), un roman qui rappelle à s’y éprendre Le quai aux fleurs de Malek Haddad.
Le schéma narratif semble avoir été inversé dans une perspective iconoclaste. En 1995, une Algérienne, Thelja, laissant mari et enfants à Alger, va retrouver son amant François à Strasbourg, son aîné de vingt ans, et vivra intensément avec lui neuf nuits. Nous sommes en pleine période de trouble terroriste et l’Algérie est dans la tourmente.
Femme courageuse et intègre, romancière confirmée et consacrée, Assia Djebar partage, certes, avec certains écrivains le statut de commandeur des arts et des lettres françaises, voire la légion d’honneur, mais elle a réussi ce dont beaucoup rêvent à en mourir : l’immortalité académique. Elle l’a arrachée. Elle l’a gagnée. Et c’est justice de compter parmi les grands, Michel Butor, Michel Serres, Claude Levi-Strauss, Eric Orsena, Jean d’Ormesson et j’en oublie sans doute d’aussi illustres !
M. L. M.
(*) Professeur de l’enseignement supérieur, écrivain. Vice-président du Conseil scientifique de l’Académie africaine des langues.